Les déductions fiscales ne sont pas essentielles au mécénat, alors qu’elles représentent un coût important pour les finances publiques, estime Jean-Michel Tobelem dans une tribune au « Monde ».
Les défenseurs de la loi sur le mécénat se tiennent en alerte, pour des raisons à la fois stratégiques et tactiques, comme l’illustre la récente contribution dans Le Monde du 6 octobre de l’ancien ministre de la culture et actuel directeur général de la collection Pinault, Jean-Jacques Aillagon, symbole des relations incertaines entre sphère publique et intérêts privés.
Pour eux, l’avantage fiscal est primordial. C’est pourtant une erreur. En effet, de deux choses l’une. Soit – comme nous le pensons sur la foi de notre thèse « Prolégomènes à une théorie de l’organisation culturelle » (présentée en décembre 2014) – le mécénat constitue un puissant outil au service de la stratégie des entreprises ; et, dans ce cas, il n’a nul besoin d’avantages fiscaux particuliers, en dehors d’une simple déduction des dépenses engagées au titre des frais généraux de l’entreprise, comme dans le cas des dépenses de publicité et de communication. Soit il est le fait d’une prétendue générosité désintéressée, et dans ce cas, la position du mécénat dans le portefeuille stratégique des entreprises est fragile, car il peut être remis en cause à chaque changement de direction.
Le beurre et de l’argent du beurre
Par ailleurs, l’agressivité de certaines fondations d’entreprise a fait prendre conscience au public et à la représentation nationale que celles-ci cherchent parfois à bénéficier du beurre et de l’argent du beurre : à savoir à la fois une image de mécènes éclairés et dévoués à l’intérêt public, alors même que – légitimement – c’est l’intérêt bien compris de l’entreprise qui est concerné au premier chef ; et, dans le même temps, le bénéfice de déductions fiscales parmi les plus généreuses au monde (selon le rapport de la Cour des comptes, « Les musées nationaux après une décennie de transformation », 2011) , qui constituent en réalité davantage un effet d’aubaine qu’un effet de levier.
Aucun économiste ne confirme du reste que rendre plus avantageuses les déductions fiscales entraîne des dons proportionnellement plus importants. C’est d’ailleurs ce que l’on observe dans le domaine de la philanthropie privée. Là encore, les associations de défense du mécénat se trompent en s’arc-boutant sur la question des avantages fiscaux, alors même que ceux-ci sont clairement à l’avantage des ménages qui non seulement paient l’impôt sur le revenu, mais de surcroît figurent parmi les contribuables les plus aisés.
Autrement dit, la générosité qui conduit un individu à faire un don modeste pour une cause sociale ou humanitaire ne s’accompagne généralement pas de l’attente d’un avantage fiscal ; en revanche, les ménages les plus aisés cherchent en pratique à optimiser le montant de leur don en fonction de considérations liées à leur niveau d’imposition.
Allons plus loin. Le mécénat était censé suppléer à un certain retrait de la puissance publique, dans le domaine de la culture, du social et de l’éducation, par exemple. Et cela, alors que ce n’est pas sa raison d’être, comme le soulignait Jacques Rigaud (1932-2012), l’un des principaux promoteurs du mécénat en France, haut fonctionnaire et ancien directeur de cabinet au ministère de la culture dans les années 1960, dans Le Monde » en février 2008 : « Le mécénat est et restera marginal (…). Un désengagement de l’État dans le domaine culturel pénaliserait indirectement le mécénat ».
Il est clair que ce sont les organisations les plus puissantes et les plus prestigieuses qui tirent parti des dispositions sur le mécénatQuoi qu’il en soit, cet effet de substitution ne s’est pas produit en France, ni du reste dans aucun pays du monde. De plus, il est clair que ce sont les organisations les plus puissantes et les plus prestigieuses – celles qui bénéficient d’équipes de collecteurs de fonds professionnels et de la notoriété la plus établie – qui tirent évidemment parti, bien avant les institutions les plus modestes, des dispositions sur le mécénat.
Enfin, force est de constater que le législateur – cherchant à débusquer toute possible source de recettes pour alimenter le budget de la nation – ne peut que s’alarmer du coût de ce dispositif pour les finances publiques, de l’ordre du milliard d’euros chaque année selon le rapport d’information du Sénat de juillet 2018 (« Le mécénat culturel : outil indispensable de la vitalité culturelle », d’Alain Schmitz).
Dès lors, la raison impose de considérer que les défenseurs du mécénat, conscients de l’intérêt général, devraient cesser de s’alarmer d’éventuelles atteintes aux actuels avantages exorbitants du mécénat et devraient plutôt mener un travail de sensibilisation de deux natures.
L’un en direction des entreprises, pour mieux expliquer la nature de cette technique de communication et son apport potentiel à leur développement (image, notoriété, réputation, cohésion interne, recrutement, insertion dans l’environnement, valeurs citoyennes, attractivité du territoire, relation avec les décideurs publics, etc.) ; l’autre en direction des particuliers, pour illustrer l’apport altruiste du don aux causes relevant de l’intérêt général, qui n’a nul besoin d’être « subventionné » par la collectivité publique. En définitive, lier le sort du mécénat au maintien des actuelles dispositions fiscales est une erreur que ses défenseurs risquent de payer cher.
LE MONDE | | Par Jean-Michel Tobelem, professeur associé de gestion à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne
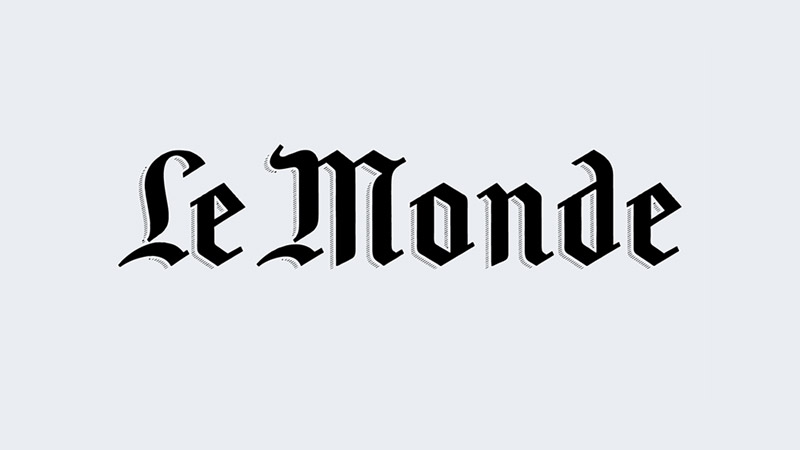
Laisser un commentaire